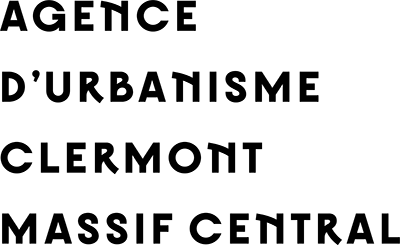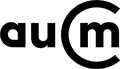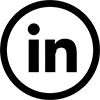L’exploration « De la culture dans la ville, à l’urbanisme culturel : les approches sensibles et artistiques au service des territoires en transitions », proposée le 16 novembre 2023 dans le cadre de la 44ème Rencontre nationale des agences d’urbanisme, s’est articulée autour d’une réflexion sur la place et les apports des démarches d’urbanisme culturel dans un contexte de réorientation écologique.
Champ interdisciplinaire émergent au début des années 2000, l’urbanisme culturel est nommé comme tel par le Polau–pôle art & urbanisme, en 2018. S’appuyant sur des interventions artistiques et culturelles situées, cette démarche intervient en de nombreux endroits de la fabrique des territoires, en travaillant sur la scénographie, les usages, les ambiances, les relations sociales, les relations au vivant, les paysages ou la production symbolique. En bousculant les modes opératoires traditionnels, en considérant autrement l’existant, la parole citoyenne, en dévoilant attachements et récits alternatifs, les approches sensibles, au sens large, apparaissent aujourd’hui comme un outil privilégié pour traiter les enjeux contemporains de transitions.
Dans quelle mesure les démarches de recherche et de création artistiques peuvent-elles être vues comme des moyens de transformation des représentations et de la décision collective ? Quels potentiels pour les agences et leurs adhérents ? L’exploration, sous forme d’agora participante, visait à questionner plus précisément les apports de l’urbanisme culturel et des approches sensibles pour la réorientation écologique des territoires.
De l’art de faire se croiser les mondes
En quoi l’urbanisme peut-il avoir recours à d’autres intelligences que des intelligences techniques et financières ? Comment se poser la question de l’histoire à raconter, avant celle des normes, des réglementations ? À l’heure où certains acteurs de l’art et la culture se questionnent sur leur utilité sociale, l’urbanisme s’interroge sur sa capacité à produire des projets urbains alternatifs, portés collectivement… Maud Le Floc’h, directrice du Polau, souligne l’opportunité de cette crise existentielle, pour faire se rapprocher les mondes. Rapprochement qu’il convient de tisser avec patience, en « prenant le temps », afin d’éviter les liaisons parfois dangereuses entre arts, culture, urbanisme et territoires.
Les exemples sont nombreux, qui éclairent les vertus de démarches où les « forces artistiques » entrent en dialogue avec les processus de fabrique urbaine et territoriale : un élu/un artiste, expérience fondatrice imaginée en 2002 au Polau ; les Lieux infinis, d’Encore Heureux, lieux pionniers qui expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde ; Jour inondable, expédition artistique conçue par la Folie Kilomètre autour du risque inondation en bord de Loire… Maud Le Floc’h précise les apports spécifiques de la méthodologie artistique, qui compose avec le contexte, négocie avec les parties prenantes, intègre, active et souvent renverse les perspectives… Apparaît alors une nouvelle « éditorialisation » du territoire mêlant petits et grands récits, dans une logique « oblique », à la charnière de méthodes ascendantes et descendantes.
L’expérimentation Transfert [1], menée de 2018 à 2023, à Rezé (Loire-Atlantique), met en lumière les tensions qui peuvent émerger autour de projets à la croisée des mondes, l’importance de la gouvernance et la nécessité de « traductions » pour accompagner ces dynamiques hybrides et hors normes. Fanny Broyelle, membre de l’académie de l’urbanisme culturel hébergée au Polau et pilote du projet, évoque ainsi les malentendus qui ont émergé au gré du développement de cette ambitieuse aventure dédiée à la transition d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) de 15 hectares. Malgré l’abondance de financements, malgré l’adhésion des habitants à l’univers artistique, l’alchimie semble ne pas avoir opéré, entre aménageurs, urbanistes et élus à la culture. Faute d’un portage politique adapté, le projet de ZAC et le projet artistique ont ainsi temporairement cohabité, sans parvenir à se nourrir l’un l’autre.
Itinéraires bis
Au-delà de l’urbanisme culturel à proprement parler, l’hybridation des approches, à des degrés divers, semble une voie possible vers des projets urbains et territoriaux davantage ancrés et donc plus robustes en contexte de réorientation écologique.
À Saint-Omer (Pas-de-Calais), le portage du Pays d’art et d’histoire (PAH) par l’agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine Pays de Saint-Omer (AUD) depuis 2013 – cas unique en France – crée une synergie qui facilite les approches transdisciplinaires. Cette mise en proximité confère au label PAH un rôle d’ingénierie active dans les politiques d’aménagement, tout en apportant une légitimité dans les actions culturelles. Sans toutefois s’inscrire dans le mouvement de l’urbanisme culturel, l’agence du Pays de Saint-Omer s’attache ainsi à faire travailler ensemble urbanisme et culture. L’approche patrimoniale s’intègre ainsi naturellement dans l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou dans les projets pré-opérationnels (restauration, renouvellement urbain…). Des visites à deux voix sont régulièrement organisées, associant chargés d’études et guides conférenciers, où le patrimoine sert de porte d’entrée pour sensibiliser le public aux défis écologiques. L’agence expérimente également les résidences d’artistes en accompagnement de mutations urbaines.
Basée à Cunlhat (Puy-de-Dôme), l’association Rural Combo conçoit des démarches expérimentales mêlant architecture, design, gouvernance, urbanisme, écriture, action artistique… Éloignée des codes du mouvement de l’urbanisme culturel, elle s’implique aux côtés des habitants – parmi lesquels les élus – pour favoriser l’émergence de communs. Invitée à intervenir sur les questions d’aménagement, son action s’établit finalement sur la gouvernance et s’articule systématiquement sur le temps long, selon les principes de la permanence architecturale, en complicité avec La Preuve par 7 [2]. Dans le village de Pérignat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), ce sont ainsi deux ans d’ateliers, de chantiers, d’actions culturelles et artistiques, qui engagent une nouvelle manière de faire démocratie. Au sein des 7 000 m2 de l’ancien collège jésuite de Billom, l’équipe s’attache à transformer pas à pas la norme et la réglementation par le faire, vers de nouveaux possibles collectifs.
Sur le territoire voisin de Loire Forez Agglomération, l’approche culturelle se met au service de projets urbains. Un service d’accompagnement des communes souhaitant établir une stratégie de centre bourg/ville a été mis en place dans la lignée du projet de territoire issu de la fusion des EPCI en 2017. Claudine Court et Évelyne Chouvier, vice-présidentes, ont très vite compris les vertus d’une démarche croisée. Cette posture politique a permis d’initier et d’expérimenter de nouvelles formes de dialogues et de coconstruction avec les habitants, à travers la présence artistique. Malgré certaines réticences initiales, malgré les revirements liés aux élections, les expérimentations se sont inscrites dans le mode de faire de l’EPCI, au bénéfice d’un projet territorial plus directement relié aux imaginaires habitants.
De la nécessité d’un nouveau logiciel
Stefan Shankland note que la formalisation de cadres rassurants tels le label démarche à haute qualité artistique et culturelle (HQAC), qu’il développe depuis quelques années, peut favoriser l’émergence de nouvelles pratiques et mettre en valeur la qualité des processus de productions artistiques, culturels et sociaux, en levant la réticence des élus vis-à-vis de démarches sensibles hors normes. Corédacteur de la tribune « Artistes, architectes, urbanistes, écologues, osez la post-disciplinarité ! [3] », il souligne l’urgence, pour être à la hauteur des défis écologiques, de systématiser les approches et méthodologies transdisciplinaires, seules susceptibles de nous permettre d’inventer de nouveaux scénarios et de nous projeter dans ce qui n’est « pas encore là ». Ce qui induit la mise en place de dispositifs de soutien financier au croisement de l’écologie, des arts et de l’urbanisme.
Qu’elles se revendiquent, ou non, de l’urbanisme culturel, les approches sensibles – hybrides, sur mesure, basées sur le lien, le faire-ensemble, et le pari de l’intelligence collective et citoyenne – semblent finalement tracer un chemin vers de nouveaux possibles. Elles induisent une vigilance particulière quant aux formes de gouvernance, de médiation, au portage politique, et nécessitent le dépassement de cadres disciplinaires et financiers devenus périmés au regard des défis de la réorientation écologique.