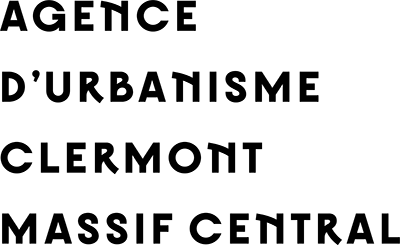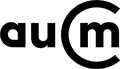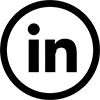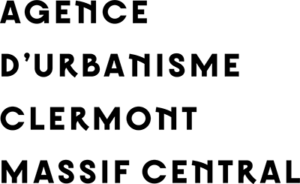« Le monde de demain ne pourra se construire qu’avec beaucoup d’intelligence collective… » – Entretien avec Simon Teyssou
Entretien avec Simon Teyssou, directeur de l’ENSACF et lauréat du Grand Prix de l’Urbanisme 2023. Propos recueillis par Claire Nénot et Christel Griffoul, juillet 2023.
Étudiant puis enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) dont il assure la direction depuis quatre ans, Simon Teyssou exerce son métier d’architecte-urbaniste au sein de l’agence L’atelier du Rouget – Simon Teyssou & associés dont le siège se situe dans le Cantal. Pour son œuvre et notamment son action en faveur des territoires ruraux, il est cette année lauréat du Grand Prix de l’Urbanisme décerné par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

©ENSACF
Votre pratique professionnelle se revendique d’un ancrage territorial fort. En quoi cette approche a-t-elle structuré votre parcours ?
Pendant mes études, la lecture du livre L’Architecture moderne. Une histoire critique de l’historien anglais Kenneth Frampton, m’a beaucoup marqué et particulièrement un des chapitres de l’ouvrage qui traite du régionalisme critique. Les nouvelles préoccupations des architectes de la seconde modernité, notamment l’importance du rapport croissant au milieu, y sont décrites. Aussi, dès le début de mon parcours professionnel, j’avais à cœur d’exercer mon métier dans les territoires ruraux, une chose très atypique à l’époque voire à contre-courant, puisque beaucoup d’architectes rêvaient de faire carrière dans les métropoles. Mais il semblait évident que pour mettre fin aux dogmes de la modernité et des grands préceptes appliqués partout dans le monde, il fallait reterritorialiser la pratique de l’architecture. J’ai alors voyagé pendant trois mois à la découverte de projets architecturaux rangés sous la bannière du régionalisme critique de la seconde modernité : au Mexique, aux États-Unis, au Portugal, en Italie, à la découverte des œuvres du portugais Alvaro Siza, de l’italien Carlo Scarpa, du mexicain Luis Barragán. Également celles d’architectes plus contemporains aux États-Unis, incarnant un mouvement dit « des architectes du désert », nom relatif à leurs œuvres situées dans le désert de l’Ouest américain. Ceci, additionné à mon intérêt pour le régionalisme critique, a orienté mon travail de fin d’études autour de la ferme qui appartenait à la famille de mon ex-femme ; une ferme située dans le « désert cantalien ».
Mon attachement au Cantal était déjà fort et je souhaitais m’y installer. La Châtaigneraie cantalienne, dans laquelle se situe la ferme dont j’ai parlé précédemment, correspond au début du sud-ouest de la France. C’est très différent du Cantal du Puy Mary et du Puy Griou : l’accent commence à chanter ; on se sent aussi proche de Toulouse que de Clermont-Ferrand ; l’architecture est méridionale. La Châtaigneraie cantalienne était un territoire autrefois très pauvre, devenu le territoire agricole le plus riche du Cantal. De grandes recompositions paysagères, des remembrements notamment, ont été pratiqués pendant toute la seconde moitié du XXème siècle. En 2000, on y trouvait peu d’architectes et je souhaitais conserver une certaine proximité avec Clermont-Ferrand au regard de ma charge d’enseignement. J’ai donc trouvé un local à louer pour 1 000 francs par mois. Mon réseau familial et amical m’a permis d’accéder aux premières commandes.
Vous montrez un certain intérêt pour les territoires hors métropole, qu’ils soient ruraux, péri-urbains ou encore, comme lors de votre travail de fin d’étude, désertiques. Pourquoi cet intérêt ?
J’avais six ans lorsqu’avec ma famille, nous nous sommes installés dans le Cantal. Nous avons sauvé l’école pour quelques années supplémentaires car désormais, l’établissement comptait neuf élèves. L’instituteur, adepte de la pédagogie Freinet, ne mettait pas de note. Il n’y avait pas de système de concurrence, pas de classement. Nous faisions des maquettes avec des courbes de niveau, comme à l’école d’architecture. Le vendredi après-midi, nous empilions le bois pour nous chauffer la semaine suivante. Nous allions faire des courses d’orientation en rase campagne. La femme de l’instituteur s’occupait du ramassage scolaire et de la cantine. C’était une grande famille. En parallèle de cela, ma mère était américaine, ce qui m’a apporté une grande ouverture d’esprit. Nous voyagions régulièrement aux Etats-Unis et nous partions en camion pendant toutes les vacances scolaires, au Maroc ou en Espagne. Mes parents sont des enfants de 68 qui se sont mis au vert en reprenant la maison familiale. C’est à la fois cet ancrage ultra local dans la campagne et cette ouverture au monde qui m’ont forgé.
Il faut néanmoins insister sur la pluralité des ruralités. Le mot « territoire » est un terme très générique laissant imaginer un objet homogène. Cependant, les territoires ruraux recouvrent des réalités extrêmement diverses. On observe des territoires ruraux industriels qui se sont effondrés, comme la vallée de la Dore, Thiers, jusqu’à Ambert et La Monnerie-le-Montel. Certains sont très marqués par l’élevage, d’autres plutôt par leur appartenance à des parcs naturels régionaux ou à des zones Natura 2000. Il existe également des territoires ruraux pris dans des dynamiques métropolitaines, paradoxalement inscrits à la fois dans une forme d’intensité et une absence de vie sociale. Dans le Bordelais par exemple, des villages entiers ne sont plus habités mais le patrimoine est en parfait état car les vignobles y sont installés. J’éprouve un intérêt particulier pour les ruralités en déshérence, en difficulté comme le Cantal, la Corrèze, le Lot, l’Aveyron ou encore la Creuse. La pratique architecturale au sein de L’Atelier du Rouget porte sur ces territoires en difficulté, avec la perspective qu’il s’agit de territoires amenés à devenir désirables. Ils ont en effet été relativement épargnés par l’industrie ou l’agriculture intensive et le climat est meilleur. Il y a alors un enjeu important : quelles sont les incidences de cette nouvelle désirabilité sur la transformation spatiale ? Comment organiser cette rencontre entre ceux qui vont venir des métropoles et les autochtones globalement très conservateurs, où les classes populaires et défavorisées sont surreprésentées, avec un rapport culturel très différent des urbains ?
Votre œuvre, à contre-courant de vos collègues au début de votre carrière, est aujourd’hui saluée par l’obtention du Grand prix de l’urbanisme 2023. Cela traduit-il une nouvelle perception du rôle des architectes et urbanistes dans les territoires ruraux par les pouvoirs publics ?
Cette reconnaissance nationale récompense peut-être le caractère pionnier de notre architecture et notre urbanisme dans les territoires ruraux. C’est également un concours de circonstances : le centre d’intérêt s’est un peu déplacé vers la question des ruralités et des campagnes, là où je me situais. Suite notamment au mouvement des gilets jaunes, le gouvernement a porté une certaine attention aux territoires non métropolitains comme le montrent les programmes « Action Cœur de ville », « Petites villes de demain » et plus récemment, « France Ruralité ». Enfin, ces prix sont souvent attribués à des profils plutôt métropolitains voire parisiens. J’imagine que le jury a souhaité mettre en lumière des pratiques plus marginales.
Certains projets, dans le cadre desquels nous sommes allés assez loin en matière d’intégration territoriale en articulant urbanisme, paysagisme et architecture, sont assez emblématiques de nos pratiques et du rôle que l’on peut avoir dans la définition de l’espace public et plus largement dans l’articulation d’un territoire tout entier. Ces projets impliquent, par exemple, une adaptation forte de la manière de concevoir afin d’assurer l’obtention du marché par le tissu artisanal local. Lorsque nous faisons quelque chose, c’est à l’échelle locale, presque familiale : en dessinant un projet en bois impliquant l’utilisation de ressources locales, cela a une incidence sur l’économie locale, sur les filières régionales de bois. Un de nos récents projets, à Mandailles-Saint-Julien, s’inscrit pleinement dans cette démarche. Nous avons réinvesti une école pour en faire un espace de tourisme et de logements. Par ailleurs, nous avons renaturé une berge de la Jordanne, auparavant dégradée et saturée de camping-cars, de poteaux téléphoniques et de plantations stupides. Une halle dédiée à l’accueil de marchés et d’évènements culturels et sportifs a remplacé un terrain de tennis désaffecté et sa zone de stationnement délabrée. La création d’un grand parking situé à l’entrée du village, élément de la commande initiale, a été remplacée par la construction d’une petite passerelle permettant de relier le bourg à un délaissé routier faisant office de zone de stationnement par un chemin plutôt que par la route.
L’architecte a ainsi toute sa place pour penser un projet d’espace public et de paysage, à condition qu’il se donne les moyens de pouvoir s’intéresser au vivant qui l’entoure et à son environnement. Quelle est la culture et l’histoire du lieu ? Comment agit-on avec parcimonie ?
Le lien entre les projets que vous portez et les enjeux de réorientation écologique est évident. De quelle manière ces enjeux sont-ils entrés dans vos travaux ?
J’ai été marqué par de nombreux livres sur l’écologie ou par des romans apocalyptiques, en particulier par La route de Cormac McCarthy. J’ai compris qu’on allait droit dans le mur et il m’a fallu plusieurs années pour faire le deuil du « développement durable ». Ce n’est plus une question de développement durable, il s’agit aujourd’hui de réfléchir à la manière dont on peut décélérer pour prendre le mur un peu moins vite.
Cette sensibilité aux enjeux écologiques se joue aussi dans la conscience du rôle à jouer pour ma profession au vu de la nécessaire bifurcation écologique. J’exerce ce rôle, d’une part, à travers mon implication au sein de l’École d’architecture. En effet, l’écologie a longtemps été un non-sujet dans les écoles d’architecture : lorsque j’étais étudiant, il y a 25 ans, on ne parlait pas du vivant, du réchauffement climatique, des mobilités, des ressources… Tout le travail de l’équipe enseignante de l’ENSACF est aujourd’hui de faire émerger ces sujets et d’en nourrir le projet de l’établissement. D’autre part, j’essaie de changer les choses par l’action, par ma pratique professionnelle et à l’échelle locale car je pense que c’est le seul moyen de le faire. La manière de construire les projets dans les territoires ruraux constitue une sorte de préfiguration de ce qui pourrait se passer à l’échelle planétaire. D’une façon similaire, des inventions apparaissent dans les pays émergents et certains prennent beaucoup d’avance par rapport à nos habitudes métropolitaines. Faire avec moins d’argent, être plus attentif aux choses « déjà-là » …
La prise en compte du « déjà-là » et la transformation des manières d’envisager les projets urbains et architecturaux appelle à une forte recomposition des pratiques professionnelles. Où en est-on aujourd’hui ?
C’est assez paradoxal. On ressent l’entrée dans un nouveau monde tout en ayant du mal à mettre des mots sur ce qui se passe et sur les façons dont on peut imaginer les perspectives de cet autre monde. Nous sommes à une période charnière de notre histoire au cours de laquelle des mutations vont s’accélérer. Cela nécessite que l’ensemble des professions suivent ce mouvement et que le cadre réglementaire évolue.
L’école d’architecture de Clermont-Ferrand a de l’avance sur ces sujets et nos étudiants nous poussent. Cependant, ce qu’on leur raconte à l’école sur la manière de reconsidérer la question des ressources, de prendre soin du « déjà-là » … se heurte au monde « d’avant ». J’ai eu la faiblesse de penser que les outils qu’on donne aux étudiants sont suffisants pour agir correctement. Force est de constater que le cadre professionnel pour mettre en œuvre ces outils n’est pas encore là, le monde économique n’est pas prêt. Il suffit de voir l’architecture entièrement carbonée qui nie l’impératif écologique qui se construit dans la métropole clermontoise. Le secteur du bâtiment est aujourd’hui confronté à des problématiques considérables de savoir-faire, de compétences, de manque de main-d’œuvre. Ces problématiques se sont accentuées depuis la pandémie et d’autant plus dans les territoires un peu reculés.
Cette réorientation écologique demande ainsi une immense remise en question. ll faut sans doute construire moins, ce qui signifie par ailleurs arrêter de démolir ; construire autrement ; habiter peut-être autrement. Je pense aussi qu’il ne faut pas avoir peur de dire que nous n’avons pas toutes les solutions.
Les territoires disposent souvent d’un savoir-faire en matière de construction et d’habitation qui, avant l’essor du modernisme et de l’architecture standardisée et mondialisée, leur a donné leur spécificité. Cet habitat vernaculaire présente-t-il selon vous aujourd’hui un intérêt particulier ?
L’habitat vernaculaire raconte la façon dont on construisait les maisons. Dans le Cantal, en se promenant dans les chemins, on peut observer des trous : c’est ici et non dans les carrières lointaines qu’on allait chercher les pierres destinées aux constructions. Les bâtiments s’orientaient en fonction du vent dominant et de l’ensoleillement. Ce sont des principes bioclimatiques assez simples mais riches d’enseignement que l’on peut appliquer dans l’architecture contemporaine.
La question des ressources et de l’accessibilité aux ressources locales est cependant aujourd’hui très différente. Pour illustrer ce propos, le bois produit dans le Cantal devient moins disponible depuis trois ans car les arbres sur pied sont vendus en Chine ou aux États-Unis. Aussi, même s’il y a une forêt de Douglas à maturité à quelques mètres de chez soi, il est difficile de l’utiliser pour bâtir ici. Cette difficulté d’accès aux ressources locales rend toute transposition directe de l’habitat vernaculaire dans nos pratiques architecturales actuelles impossible. C’est invraisemblable et ceci doit faire l’objet d’une question nationale : comment protège-t-on nos ressources ? Cependant, l’habitat vernaculaire a de beaux jours devant lui puisqu’on remarque, notamment dans le Cantal, le rachat de très nombreuses granges et étables à l’abandon depuis 50 ans.
Si l’on prend l’exemple du Massif central, le plan de masse ne changera pas ; il n’y aura pas de bâti supplémentaire. A ce titre, il faudra, entre autres, modifier notre rapport au patrimoine pour réinvestir les constructions anciennes avec plus d’invention car les cadres réglementaire et culturel actuels ne permettent pas cette transition et le Zéro artificialisation nette ne va rien résoudre. En effet, dans les territoires ruraux reculés, l’achat de pavillons de seconde main des années 1970 et 1980 se poursuivra tandis que l’immeuble du centre-bourg ou du centre-ville continuera à se dégrader car on ne peut toujours pas y aménager une terrasse tropézienne, un balcon, une véranda, ou transformer son rez-de-chaussée.
Au-delà de la transformation du rapport au patrimoine, on peut imaginer que les architectes de demain pratiqueront leur métier de façon différente, autour de nouvelles valeurs. Comment envisagez-vous cet avenir ?
Le monde de demain ne pourra se construire qu’avec beaucoup d’intelligence collective, ce à quoi nous essayons de préparer nos étudiants. Les enseignants de cette école sont, au même titre qu’eux, des apprenants. Il faut expérimenter, se montrer humble tout en portant des convictions fortes, c’est pourquoi nous ne prétendons pas détenir le savoir et la solution ; la figure de l’enseignant qui professe son enseignement à des étudiants n’est plus d’actualité, nous avons changé de monde. Par ailleurs, je suis convaincu qu’il faut croiser les regards et les disciplines pour être plus pertinents sur nos projets. Pour une école comme la nôtre, cela signifie de former des gens polyvalents et agiles capables de répondre à des situations très différentes.
En agence, les projets d’espaces publics urbains où l’on essaie de porter une démarche réflexive offrent matière à une forme de transmission. Nous tentons d’expliquer ce que l’on fait, de théoriser, de produire de la connaissance notamment sur la réhabilitation du patrimoine bâti, qu’il s’agisse du patrimoine du XIXème, du XXème siècle, vernaculaire ou industriel. La réhabilitation est en effet le grand enjeu du XXIème siècle. Pour évoquer un sujet polémique, je pense qu’en 2023 la destruction d’une barre comme la muraille de Chine à Clermont-Ferrand est une erreur. L’avenir verra probablement la fin de grands projets de ce type.
On peut aussi imaginer un futur où il n’y aura plus de ZAC. Il faudra alors réinventer la manière de transformer des bâtiments en les régénérant, sans démolition majeure. Ceci nécessitera beaucoup de minutie, d’inventions, de nouvelles manières de reconstruire. Les architectes font partie des professions qui développent une vision transversale et globale, sans être pour autant spécialistes. Il faut des professionnels capables d’articuler des problématiques multiples et de synthétiser. Or, si beaucoup sont aujourd’hui des ultra-spécialistes de questions très spécifiques et se trouvent côte-à-côte, sans se rencontrer et co-construire, la beauté de notre métier est que l’on passe notre vie à essayer de rassembler des énergies dans un projet.