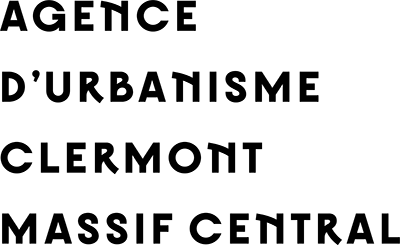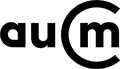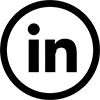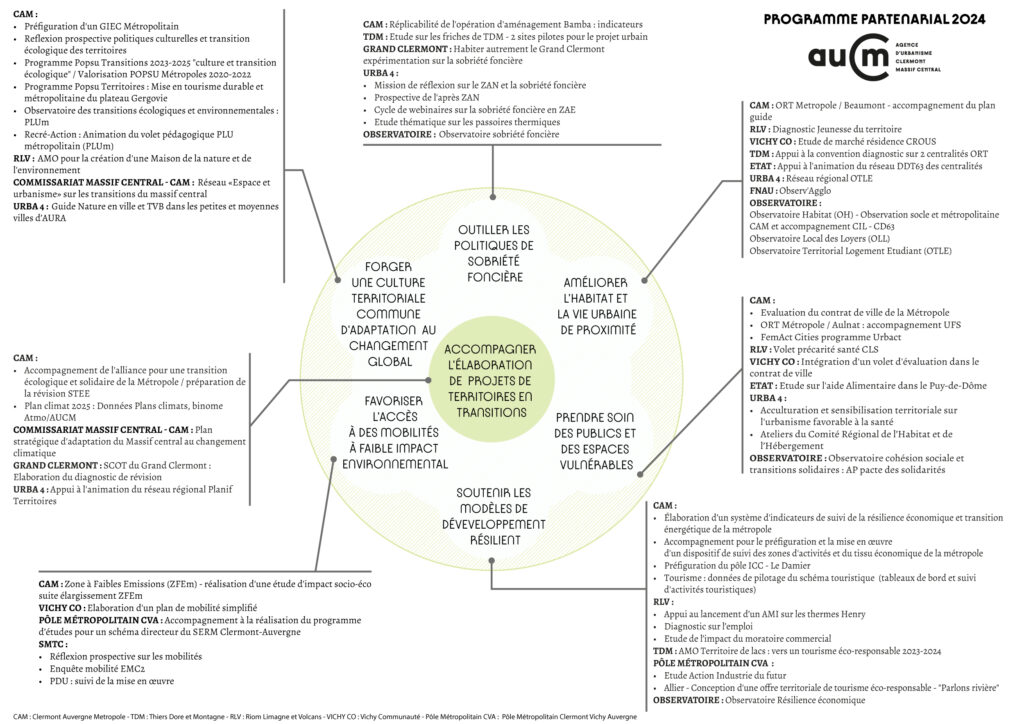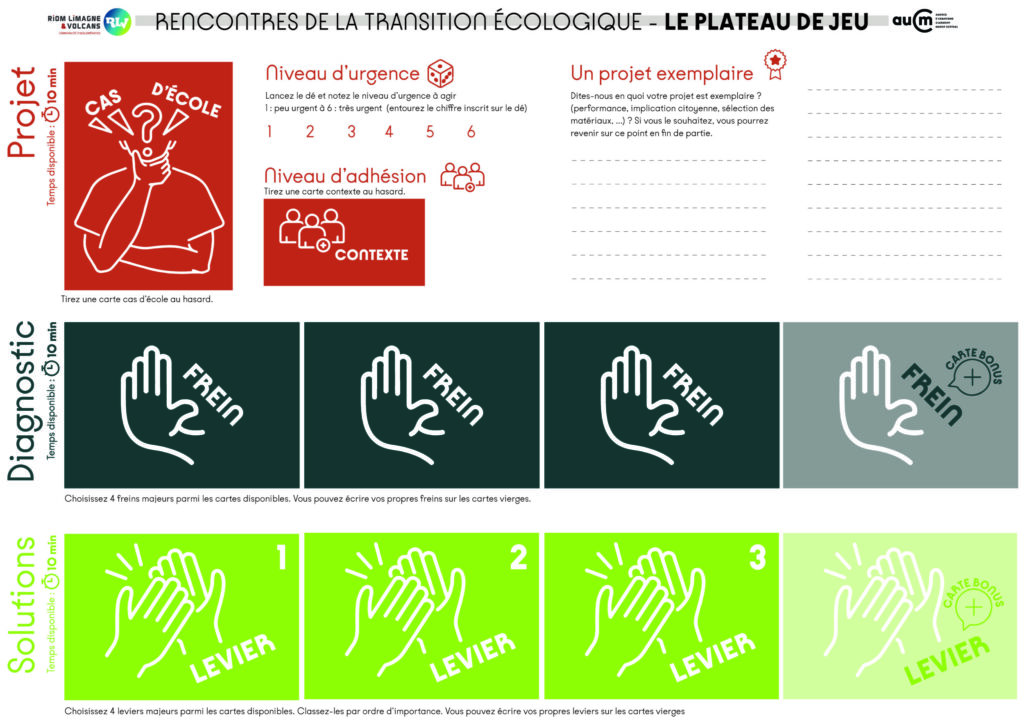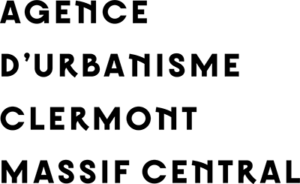Avec InspiRe, un projet de mobilité sensible, mais également social, Clermont Auvergne Métropole recompose son réseau de transport public pour régénérer le rapport à la ville, afin qu’elle profite à tous.
Changer les comportements d’hommes et de femmes libres, quelle gageure ! C’est particulièrement vrai quand ce changement ne résulte pas du fait qu’un comportement autrefois acceptable ne l’est plus aujourd’hui, mais du fait que le comportement d’aujourd’hui n’est pas acceptable, compte tenu de ses conséquences pour demain. Trente ans après le sommet de Rio – trente ans, une génération complète –, quels nouveaux traits culturels sont apparus sur notre territoire, dans nos modes de production et de consommation ? Dans nos manières de nous déplacer ?
Chacun peut en juger sur son territoire. En ce qui nous concerne, nous avons eu, Olivier Bianchi, président de la Métropole, et moi, la conviction que nous devions aller plus loin et plus fort et, pour cela, rendre physiquement clair, palpable, sur une partie de la ville d’aujourd’hui, ce que sera la ville de demain. Nous avons ainsi lancé, après un temps de concertation et de préparation important, qui s’est étalé de 2016 à 2020 et après une validation électorale en mars 2020, le projet InspiRe.
Penser les mobilités comme une expérience sensible
L’heure que nous passons chaque jour à nous déplacer est d’abord une durée avant d’être une contrainte ou un plaisir ; c’est une durée sociale, à travers la ville, dans l’espace public, avec plus ou moins d’interactions et de sens mobilisés selon notre mode de déplacement.
À pied ou à vélo, spécialement dans le coeur urbain, rien ne nous sépare du dehors. Comme aménageurs de l’espace public, nous influons fortement sur ces sensations et perceptions : bruits, vues, trajectoires à choisir, risques, odeurs. En améliorant la fluidité et la sécurité, nous redonnons la liberté aux piétons et cyclistes de s’abandonner à leurs pensées ou de profiter de cet espace du dehors. En apaisant la circulation automobile, nous modifions aussi les bruits et réduisons les odeurs de gaz d’échappement. Le travail de façade à façade et la recomposition de l’espace urbain fabriquent une nouvelle ambiance. Avec InspiRe, c’est dans cet esprit que nous retouchons la ville, en traversant de part en part, d’est en ouest, intégralement, la métropole, sur 27 km. Cela se traduit matériellement par des trottoirs plus larges, des pistes cyclables, de la végétation, des mobiliers urbains composant des scènes variées, suivant la densité de population et la microrégion naturelle.
En transport en commun, nous sommes à la fois séparés du dehors par des vitres et mélangés à la foule. Nos sens nous renvoient à la promiscuité, à des mouvements qui nous sont extérieurs et auxquels nous devons nous adapter. Nous sommes parfois préoccupés d’un retard possible, d’une correspondance à ne pas manquer ou, au contraire, plongés dans notre monde intérieur de musique ou de lecture. Quand nous élaborons les réseaux, achetons les véhicules, concevons les infrastructures matérielles et immatérielles d’information, de jalonnements, de correspondances, nous ajoutons ou nous retranchons de la fatigue à l’usager, en améliorant le confort et en réduisant le stress. Avec InspiRe, nous avons cherché une certaine neutralité. Avec le choix de la propulsion électrique, le site réservé, la priorité aux feux : peu de secousses, un intérieur lumineux et peu sonore. Des mobiliers urbains simples, épurés, discrets, qui se repèrent, mais ne se donnent pas en spectacle. Un nouveau système d’information voyageur, accessible pour tous, qui rassure. Nous offrons aussi de nouvelles possibilités pour les habitants de se faire conduire – c’est un luxe – et donc de dédier ce temps de transport à une activité contemplative ou personnelle.
Si nous sommes en voiture – ce sera évidemment de moins en moins tout seul et de moins en moins de porte à porte –, nous percevons alors la ville, essentiellement, par la vue. Nous exerçons un effort de conduite et sommes également préoccupés par les risques d’embouteillage, d’accrochage, les déviations éventuelles, la recherche d’une place de stationnement. Pour nous, qui n’oublions pas que la voiture est le principal mode de déplacement, dans les conditions actuelles d’urbanisation qui se modifient sur le temps long, nous nous efforçons de compenser les augmentations de temps de parcours par une diminution de la fatigue. Nous fluidifions le trafic en réduisant les écarts de vitesse (c’est la ville à 30 km/h) et nous réduisons les détours en réinstallant des double-sens, à la place de deux ou trois voies à sens unique.
De manière générale, ce passage par le sensible nous oblige à penser le geste quotidien, l’individu et le groupe, pour qui nous réalisons l’aménagement. Que vivra-t-il ? À quoi a-t-il droit ? Qu’est-ce qu’il est juste de lui proposer et en fonction de quels critères ? Comment améliore-t-on le ressenti collectif, la qualité, l’accès ? Derrière chacune de ces questions, il y a de nombreuses orientations politiques. En réalité, comment pourrait-on provoquer un changement de comportement consenti par les citoyens si on n’associait pas sensation et représentation ?
Engager le débat, reconfigurer l’espace-temps, vers une société du
« mieux » mobile
Pour conduire cette transformation urbaine qui permette de vivre pleinement la ville, nous nous sommes engagés de manière continue sur le temps long de deux mandats municipaux. Cet engagement installe sur de longs mois, dans le débat public et, par ricochet, dans les conversations familiales, amicales, professionnelles, une réflexion sur la mobilité. Conservatrices ou progressistes, avec des points de vue variés, ces conversations ou diatribes sont une manifestation d’un possible changement d’habitudes. C’est pourquoi, nous avons placé le dialogue, avec tous les habitants, au coeur de la conduite de projet, en choisissant de mener des concertations bien plus fournies que les standards, en durée et en volume, en déclenchant l’enquête publique à un stade d’études préliminaires avancées, avant d’avoir bouclé l’avant-projet, pour que le dialogue soit effectif et puisse être pris en compte dans la réalité des aménagements.
Notre projet de mobilité n’est pas que sensible, il est également social, pour que la ville profite à tous.
Derrière ce slogan de mobilité pour tous, on peut entendre plusieurs principes. Nous cherchons à fabriquer une société « mieux » mobile, et pas « moins » mobile. Nous cherchons à maintenir les temps de parcours et à mieux les répartir entre les modes et les gens. Nous cherchons à favoriser les modes réellement urbains – c’est-à-dire ceux qui nous font pleinement vivre la ville – et non pas à restreindre l’accès à la ville.
Le large univers de possibles qu’offre la ville ne vaut ainsi que s’il est effectivement possible, donc accessible, financièrement bien sûr, mais déjà et en premier lieu physiquement. Or, les lieux recherchés évoluent avec l’air du temps, la désirabilité. Le regard nouveau que nous portons à l’épuisement des ressources non renouvelables, à l’énergie, à la pollution façonne aussi ce que nous jugeons agréable et nos loisirs s’en trouvent modifiés.
Le transport joue ainsi un rôle déterminant dans ce qu’est la ville réelle, celle qui nous est effectivement accessible dans notre budget-temps et notre budget-prix. Nous avons déjà pu évaluer, quantitativement, ce que la tarification solidaire et la gratuité du week-end généraient de déplacements nouveaux pour des citoyens autrefois empêchés. En déployant davantage d’offres, à moitié sur les deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) et à moitié sur le reste du réseau, nous agrandissons l’espace accessible d’une partie significative de la population et nous agrandissons la plage horaire où l’on peut être hors de chez soi. Par exemple, avec InspiRe, nous relions la ville de Clermont-Ferrand à celle de Cournon-d’Auvergne, où coule l’Allier qui est la grande rivière métropolitaine, toutes les 6 minutes, à l’heure de pointe, tous les jours de la semaine, de 5 h à 1 h du matin. Les bords de l’Allier deviennent plus accessibles, en particulier depuis l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), désormais tous situés le long d’une ligne forte.
En quelques mots, notre projet InspiRe constitue une proposition pour un changement de rapport à la ville, passant par le sensible, qui éclaire le bénéfice des transitions en cours.